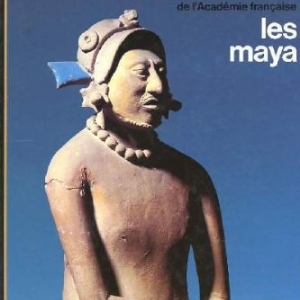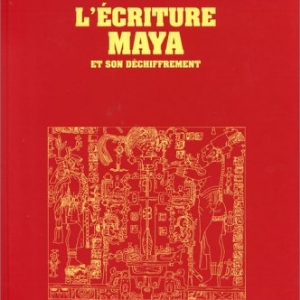lettres électroniques

Où trouvons-nous cette écriture ?
Au milieu du siècle dernier, des voyageurs américains et européens s’enfoncèrent dans les forêts tropicales du Guatemala ou du Chiapas au Mexique à la recherche de cités antiques disparues. C’est ainsi que le diplomate américain John Lloyd Stephens et le dessinateur anglais Frederick Catherwood découvrirent en 1839 et 1840 les sites de Copan et de Palenque. Ils publièrent dans un ouvrage célèbre, Aventures de voyage au pays maya, les premiers dessins fidèles des inscriptions glyphiques des stèles de Copan et des panneaux des temples de la Croix, de la Croix Feuillue et du Soleil de Palenque.
De fait cette écriture appartient à une civilisation qui s’est développée du IIIe au Xe siècle après J.-C., dans la région sud-est du Mexique, principalement dans la péninsule du Yucatan et dans les Hautes Terres du Chiapas. Nous la retrouvons au Guatemala dans la région du Peten et des Hautes Terres et enfin sur l’actuel territoire du Belize. Cette culture est caractérisée par une société semi-urbaine vivant dans des cités de pierre structurées par un ensemble de temples, cours, palais et jeu de balle. Les tombes des seigneurs contenaient en particulier des vases polychromes et des codex près du défunt. Sur ceux-ci sont peints des caractères hiéroglyphiques selon un style cursif. Si de nombreux vases ont été exhumés lors de fouilles archéologiques ou de pillages de tombes, les codex n’ont malheureusement pas survécu à un climat tropical chaud et humide. Néanmoins quatre codex sont conservés dans les bibliothèques de Dresde, de Madrid et de Paris. Ils datent de la période postclassique, c’est-à-dire du XIVe siècle pour celui de Dresde, du XVe siècle pour le codex de Paris et du XVIe siècle pour celui de Madrid. Le quatrième, le codex Grolier, a été découvert en 1971 par un professeur américain de l’université de Yale, Michael Coe. Il appartenait au collectionneur mexicain Josué Saenz et semble dater du XIIIe siècle selon une analyse au carbone 14 de son support. Tous ces codex ont été écrits dans la région du Yucatan.
L’écriture hiéroglyphique est aussi sculptée sur des monuments de pierre, des stèles ou des autels placés dans les cours en face des temples ou sur les marches des escaliers conduisant aux temples bâtis sur plusieurs plates-formes comme le grand escalier de Copan. Cette écriture se retrouve également sur les linteaux de portes de temples ou de palais, les plus beaux étant ceux de Yaxchilan. Enfin, les textes peuvent couvrir les panneaux placés au fond des temples comme à Palenque pour les temples de la Croix, de la Croix Feuillue et du Soleil. Les dates extrêmes de ces monuments vont de la stèle 29 de Tikal datée de l’an 292 après J.-C. au monolithe 101 de Tonina de l’an 909 après J.-C.
Quelle langue parle le scribe maya ?
Cette civilisation disparue pouvait parler près de vingt-huit langues d’un même groupe linguistique, d’après le dénombrement fait à l’arrivée des Espagnols au début du XVIe siècle. Actuellement cinq millions d’indigènes parlent encore ces langues : les Yucatèques, les plus nombreux, sont six cent soixante-cinq mille et vivent encore près de sites de Chichen Itza, Coba, et Xcalumkin au nord Yucatan ; les Itzas, très peu nombreux, cinq cents environ, vivent près des sites autour du lac Peten proche de Tikal. De même cinq à six cents Yucatèques Lacandon demeurent près des sites de Bonampak et Yaxchilan dans la vallée de l’Usumacinta. Les Chol Palencano, au nombre de cent mille, habitent les villages autour de Palenque au Chiapas et trente mille Chorti vivent toujours dans la région de Copan au Honduras.Les récents déchiffrements, notamment des glyphes des mois, confirment la présence du groupe Chol du IIIe au Xe siècle dans la région de l’Usumacinta, du Peten et du Rio Motagua où sont situées les principales villes à l’apogée de la civilisation maya, tandis que le groupe Yucatèque semble toujours résider au nord Yucatan. Il est néanmoins difficile de délimiter la frontière linguistique entre ces deux groupes.
Quel est le système d’écriture utilisé par les Mayas ?
Nous pouvons considérer au départ quatre types d’écritures possibles : logographique, logo-syllabique, syllabique et alphabétique.Si le nombre de signes est très petit, une trentaine, l’écriture est alphabétique. Si nous trouvons plusieurs vingtaines de signes, l’écriture est syllabique. Si le nombre passe à plusieurs centaines, l’écriture devient logo-syllabique. Enfin si le nombre est de plusieurs milliers de signes, l’écriture sera logographique. Or le nombre total de signes de l’écriture maya est de neuf cents à mille deux cents, elle peut donc faire partie de la famille logo-syllabique comparable à l’égyptien classique (734 signes), au hittite (497 signes) ou au cunéiforme (598 signes).
Depuis longtemps nous savons que l’écriture maya se présente sous forme de glyphes inscrits dans un bloc rectangulaire. Chaque glyphe est composé d’un élément graphique plus grand au centre autour duquel gravitent des éléments mineurs appelés affixes par l’ensemble des chercheurs. Leur position est précisée par leur dénomination : préfixe, suffixe, postfixe, etc.
Trois sortes de signes peuvent être distinguées :
– une forme symbolique – une barre avec trois points pour le chiffre 8 ou une fleur à quatre pétales – symbolisant le soleil pour le jour Kin ;
– une tête anthropomorphe – tête de profil de la divinité Maïs pour noter le nombre 8 et la tête de la divinité solaire – pour désigner le jour Kin ;
– enfin la figure anthropomorphe – le même nombre 8 est représenté par la divinité Maïs entière et le jour Kin avec la divinité solaire complète.
Le glyphe peut s’associer en groupes glyphiques, phrases et textes. Ces textes peuvent se lire de gauche à droite et de haut en bas.
En 1962, l’archéologue anglais Eric Thompson a établi un catalogue de 862 signes tirés des textes des trois codex, des monuments et des vases. Mais ce catalogue pourrait être selon nous élargi à mille deux cents signes. Ces signes peuvent correspondre soit à des logogrammes notant des racines consonne-voyelle-consonne (CVC), soit des signes syllabiques notant des valeurs phonétiques de type consonne-voyelle (CV).
Les étapes du déchiffrement
1 – Approche structurale ou sémantique de l’écriture mayaContrairement au cas égyptien ou hittite, nous n’avons pas de textes bilingues. Les conquérants espagnols n’ont pas annoté de codex maya comme cela a été le cas pour certains codex aztèques où la traduction espagnole figure à côté du glyphe. Néanmoins Diego de Landa, deuxième évêque espagnol du Yucatan (1524-1579), nous a laissé les glyphes des dix-huit mois et des vingt jours avec le nom Yucatèque et un pseudo-alphabet de vingt-sept signes s’avérant être une partie d’un syllabaire. Il a écrit la Relation des Choses du Yucatan dans lequel ce pseudo-alphabet présente les valeurs syllabiques : cu, ku, ca, ka, ti, ma. De même, au commencement de chaque glyphe de mois, sont indiqués des compléments phonétiques indiquant la lecture Maya Yucatèque du mois d’origine Chol. Ainsi le premier mois Pop est précédé de la forme syllabique po-p (o) indiquant bien la lecture Yucatèque Pop et non le nom Chol Kanhalab.
Du XVIe au XVIIIe siècle, des religieux espagnols rédigèrent des grammaires et des dictionnaires de langues mayas principalement Yucatèque, Cholti, Tzeltal ou Quiche Cakchiquel. Les indigènes mayas ont écrit des chroniques dans leur langue dans plusieurs villages du Yucatan relatant des rituels religieux, l’histoire de leurs ancêtres et les pronostics des cycles de Katun, ou période de vingt ans, inspirées d’anciens codex disparus.
Ce n’est qu’au début du XIXe siècle que des Américains et des Européens commencèrent à s’intéresser à l’écriture des monuments et des codex copiant les inscriptions des monuments en particulier des sites de Palenque et de Copan. En 1860, un prêtre français, Brasseur de Bourbourg, curé de Rabinal dans les Hautes Terres du Guatemala, découvre des documents importants, tel le manuscrit du Popol Vuh écrit en Quiché qui relate les mythes mayas de la création du monde et des quatre lignées d’Utatlan, l’ancienne capitale Quiche. À Madrid, il révèle le manuscrit de Diego de Landa et son pseudo-alphabet. Enfin il reconnaît le codex Troano appartenant à un collectionneur, membre de l’Académie royale d’histoire de Madrid. Il remarque qu’il est la première partie d’un autre codex appelé Cortesianus et déposé à la bibliothèque de Madrid. Puis Léon de Rosny découvre le codex Perez dans une corbeille à papier à la Bibliothèque nationale portant le nom de son ancien propriétaire.
À la fin du XIXe siècle, plusieurs chercheurs américains et allemands – C. Thomas, E. Seler, P. Schellhas et E. Forstemann – peuvent identifier les glyphes du calendrier, c’est-à-dire les nombres, les jours, les mois et les autres périodes de temps sur les monuments et dans les codex.
En plus du relevé photographique et dessiné des inscriptions des monuments fait par l’Autrichien T. Maler et l’Anglais A. Maudslay, plusieurs catalogues de signes sont rédigés par W. Gates (1931), G. Zimmermann (1956), Y Knorosov (1963) et surtout E. Thompson (1962).
Les années soixante sont marquées par trois événements majeurs dans le déchiffrement. En 1952, le linguiste russe de Saint-Pétersbourg Y. Knorosov découvre le caractère syllabique de l’écriture maya marqué par un système de signes notant des valeurs syllabiques de type CV tel que CV-C (V) où la voyelle de la deuxième syllabe devient muette. Ainsi le glyphe du chien est composé de deux signes notant les valeurs : tzu et lu soit tzu-l (u) Tzul (chien). En 1958, l’archéologue allemand H. Berlin installé au Mexique découvre un glyphe emblème spécifique de chaque site important. En 1962, E. Thompson établit un catalogue de 862 signes. Mais, en 1960, l’archéologue d’origine russe T. Proskouriakoff résidant aux États-Unis identifie les glyphes nominaux de sept souverains à Piedras Negras. Puis elle reconnaît les noms de plusieurs seigneurs à Yaxchilan en 1962 et 1963. Elle isole également les dates et les glyphes de naissance, d’accession au pouvoir et de mort associés avec chaque souverain. Elle peut ainsi reconstruire une partie de la généalogie des souverains de ces deux sites. À la suite de cette découverte les chercheurs nord-américains et moi-même allons reconnaître une série de généalogies de souverains des cités de Quirigua, Palenque, Naranjo, Copan, Chichen Itza et Tikal.
Ainsi j’ai pu reconstituer la dynastie des premiers souverains de Palenque en 1975,1976, parallèlement aux travaux de L. Schele et P. Mathews. À la même période j’ai fait un essai de reconstruction de la dynastie de douze souverains de Copan à partir de l’étude des côtés de l’autel Q.
Enfin, en 1977, j’ai identifié les glyphes nominaux de neuf dignitaires de Chichen Itza ainsi que divers glyphes d’alliances, titres et emblèmes. Ces dignitaires semblent être des alliés ou des vassaux du seigneur Kak u Pacal reconnu en 1962 par l’américain D. Kelley. Ainsi cette approche structurale a permis de repérer des glyphes nominaux désignant des personnages historiques masculins et féminins, des seigneurs, des vassaux, des sculpteurs et des captifs.
Dans une première étape les glyphes ne peuvent être lus phonétiquement. Ils furent d’abord désignés par un chiffre, une lettre ou une dénomination dans la langue du chercheur ainsi « Oiseau-Jaguar » à Yaxchilan ou « Seigneur-Jaguar » à Palenque. De même des glyphes titres accompagnent les glyphes nominaux de ces personnages. Les premiers ont été identifiés par T. Proskouriakoff comme c’est le cas du titre féminin noté par une tête féminine de profil précédée de l’élément vase renversé sur lequel est infixé le jour Kin.
Le glyphe événement est un glyphe verbal suivant la date et précédant le groupe nominal dans une phrase intransitive de type : Date-Verbe-Sujet.
II – Approche phonétique de l’écriture Maya
Dans cette approche, deux écoles ont longtemps prédominé. L’une reprend l’hypothèse logographique de E. Thompson et de T. Barthel et l’autre l’hypothèse logo-syllabique de Y. Knorosov et D. Kelley. E. Thompson conçoit un système logographique où les logogrammes sont utilisés comme signes de mots proches des écritures aztèques ou chinoises. Ainsi il lit le glyphe de la sécheresse : KIN-TUN-HAAB-il. Chaque élément principal correspond à une racine de type CVC et les affixes graphiques à des morphèmes comme les couleurs ou à des suffixes grammaticaux tel : -il dans l’exemple ci-dessus. Il y a peu d’utilisation de signes syllabiques.
La deuxième école logo-syllabique a suivi le système morphémo-syllabique de Y. Knorosov qui reconnaît dans les signes logographiques un système syllabique où la voyelle de la deuxième syllabe devient muette. Son principal représentant américain, D. Kelley, va accepter ce système tout en modifiant la terminologie du Russe.
En 1978, dans une thèse consacrée à l’écriture maya, un épigraphiste américain de l’université de Stanford, J. Justeson, introduit l’idée de compléments phonétiques.
Plus récemment une grammaire se constitue peu à peu avec les travaux de L. Schele (1982), B. Macleod (1983) et V. Bricker (1986).
Les principes de l’écriture Maya
Actuellement la plupart des chercheurs mayisants s’accordent sur un type d’écriture logo-syllabique avec l’utilisation de compléments phonétiques, de déterminations sémantiques et d’une table d’environ quatre-vingt-cinq valeurs syllabiques de type CV. Cette écriture utilise trois types de signes : logogramme, syllabogramme et complément phonétique.Le logogramme est un signe morphémique où sont attachées à la fois des valeurs sémantiques et phonétiques. Ainsi le logogramme représentant une fleur à quatre pétales symbole du soleil a la valeur Kin signifiant soleil mais aussi jour, temps, période. Les valeurs logographiques sont en général des racines de type CVC.
Le syllabogramme ou signe syllabique est un signe notant une valeur syllabique composée d’une consonne et d’une voyelle notée CV ou VC. Ils dérivent de logogramme de type CVC où la deuxième consonne est faible tel : h,', w et y. Ainsi la syllabe chi dérive du logogramme CHIH (daim) et la syllabe ca du logogramme CAY (poisson).
Le complément phonétique est un signe syllabique souvent en postfixe indiquant la valeur ou une partie de la valeur phonétique du logogramme associé. Ainsi le complément phonétique ni représenté par l’affixe d’une queue de mammifère indique les lectures logographiques Tun (période de 360 jours), Kin (jour, soleil) ou Man (vision).
Pour compliquer le tout, l’écriture maya comporte de nombreux allographes, c’est-à-dire des signes différents notant la même valeur syllabique ou logographique. Ainsi la valeur syllabique ca peut être représentée par neuf signes différents. Ces nombreux signes distincts sont dus au système même de l’écriture : affixe, élément principal ou tête anthropomorphe, mais aussi au style régional ou au support de l’écriture – monument, vase, os, jade, codex ou fresque murale. Elle peut être due également à l’évolution des signes au cours du temps.
Durant ces dernières années plusieurs syllabaires ont été proposés. Les derniers sont ceux de P. Mathews (1984), D. Stuart (1987), N. Grube (1989) et moi-même (1995).
Dans mon ouvrage, L’écriture maya et son déchiffrement (1995), j’ai présenté une table de 84 valeurs syllabiques notées par 425 signes. Le dernier syllabaire de L. Schele (1997), professeur d’art à l’université d’Austin, dans son notebook indique 77 valeurs notées par 175 signes. Ces syllabaires reflètent un système phonologique Proto-Chol composé de vingt consonnes et de cinq voyelles, avec un syllabaire théorique de cent valeurs possibles.
Les divinités, les personnages historiques, les animaux et les plantes déchiffrés
En attendant une véritable grammaire hiéroglyphique, ce syllabaire nous permet actuellement de lire un grand nombre de glyphes différents, comme ceux des jours et des mois, de la série lunaire, des directions. De même dans mon ouvrage, Un nouveau commentaire du codex de Dresde (1997), nous pouvons lire beaucoup de glyphes nominaux de divinités : la divinité de la mort Cizin, de la pluie Chahc, les divinités solaire Ahaw Kin ou lunaire Ixic Uh et les divinités jumelles Hun Ahaw, « premier seigneur » et Yax Balam, « nouveau jaguar ». Sur les monuments, les noms des trois divinités principales président les lignages tels qu’ils sont inscrits sur les panneaux des temples de la Croix, de la Croix Feuillue, et du Soleil, dédiés respectivement à Ahal, l’éveilleur, Kawil, l’abondance de nourriture, et Kinich Ahaw, le seigneur au visage solaire. Il est désormais possible d’identifier le nom et la position de nombreux souverains, des membres de leur famille et de leurs vassaux. Ainsi les noms de souverains Hanab Pacal et Can Balam à Palenque, Itzam Balam et Yaxun Balam à Yaxchilan, Yahaw Chan Muan à Bonampak et Hazaw Chan à Tikal.Ces noms sont souvent accompagnés de titres qui nous renseignent sur la hiérarchie sociale de la période classique maya : par exemple le titre religieux Yahaw te' signifiant « le grand arbre ou arbre cosmique » avec lequel s’identifie le souverain ; de même le titre Ah Pitz « le joueur de balle » où le souverain lui-même joue le rôle de joueur de balle, personnifiant une divinité, avec une balle transformée en captif et accompagné de nains jumeaux, sur la marche d’un escalier de Yaxchilan. À Copan sur le marqueur central du jeu de balle, est représenté le souverain Waxac Lahun u bah Kawil jouant à la balle avec la divinité du nombre zéro et la balle dénommée Kan tun, le souverain lui-même personnifiant la divinité jumelle Hun Ahaw.
Le souverain peut être entouré de scribes, Ah Tz’ib. Ce sont eux qui ont rédigé les codex et peint les textes des vases polychromes. De même le souverain utilisait des sculpteurs Ah Pol pour graver les textes et les scènes sur les stèles, les autels ou les linteaux de pierre.
Hiérarchiquement, en dessous du seigneur Ahaw se trouvait le vassal Zahal, dont le titre était principalement utilisé dans la région de l’Ucumacinta au Chiapas et la région Puuc du Yucatan. De la même façon ont été reconnus des glyphes de parenté permettant de reconstituer l’arbre généalogique des souverains des principaux sites. Ainsi le souverain Hanab pacal de Palenque, a pour fils aîné (Zucun Winic), Can Balam et pour fils cadet (Itz’in Winic) Kan Hok Chitam, représentés sur les divers panneaux calcaires. La plupart des textes mayas ne décrivent que les principaux épisodes de l’existence des dirigeants, et seulement ceux qui se rapportent à leurs fonctions de souverains tels que leur naissance, leur accession au trône, leur décès et leurs funérailles. Mais récemment d’autres glyphes événements ont été déchiffrés, associés soit à des conflits entre cités-états – captures de dignitaires, destructions, incendies de cités –, mais aussi à des alliances ou des allégeances à des seigneurs suzerains comme ceux de Tikal ou de Calakmul, les plus puissantes cités-états de l’empire maya. De même des glyphes événements sont associés à des rituels religieux d’auto-sacrifices de sang liés à des fins de période, en particulier fin de katun – période de vingt années –, ou des danses, Akot, célébrant des anniversaires d’accession au pouvoir des souverains. Enfin des glyphes toponymes ont été identifiés, concernant les noms des cités ou des provinces qui les entourent tels les noms de Mutul pour Tikal, Xucpi pour Copan, Ziyan Chan pour Yaxchilan, ou Bac pour Palenque. Et à l’intérieur même des cités, des noms de place ont été lus sur les monuments, tel Ho' Nahb à Copan, place située devant le Grand Escalier Hiéroglyphique ou Lacam ha' à Palenque, place située entre les trois Temples de la Croix, de la Croix Feuillue et du Soleil. De même a-t-on identifié des noms de temples, de terrains de jeu de balle ou wac eb, ou des parties d’architecture comme la colonne, kal ; le linteau pacal ; la plate-forme, chan cun ; et la stèle, lacam tun.
Il est maintenant possible d’envisager la constitution d’une grammaire complète de l’écriture maya, comme l’avait fait Champollion pour les hiéroglyphes égyptiens. Dès 1986, la linguiste Victoria Bricker avait présenté une première grammaire succincte, étudiant les flexions nominales et verbales des langues mayas yucatèque et chol, comparées à celles des textes des codex et des monuments. On peut lire phonétiquement en maya cholti ou yucatèque des textes hiéroglyphiques entiers de codex, de monuments ou de vases. Comme cela a été le cas pour les autres écritures anciennes, l’accord de plus en plus général des chercheurs sur les lectures phonétiques de ces textes confirme la réussite du déchiffrement de l’écriture maya, grâce au travail collectif et pluridisciplinaire des chercheurs.